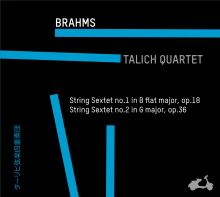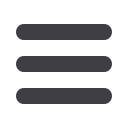

9
QUATUOR TALICH
La partition s’ouvre sur un Allegro non troppo dont le climat pastoral semble se
développer sans fin, multipliant les combinaisons sonores comme s’il s’agissait
d’une symphonie.
Parmi les nombreuses idées secondaires, on retiendra celle qui cite les notes
la-sol-
la-si-mi
donnant dans la transcription allemande les lettres A-G-A-H-E, référence
à Agathe von Siebold avec laquelle Brahms se fiança. Les modulations de cet
immense mouvement d’un quart d’heure sont audacieuses, le musicien jouant sur
un chromatisme des plus recherchés.
Le scherzo qui suit ferait songer à une page de Dvořàk car la finesse n’est pas
exempte de couleurs d’Europe centrale. Ainsi, les premiers pas d’une danse pudique
sont suivis d’un presto giocoso mu par un splendide rythme de ländler.
Par contraste, l’adagio en Mi mineur s’établit dans la rigueur de la variation. Mais
cette page, qui parut si ennuyeuse aux viennois révèle, un charme indéniable car
le thème est une mélodie d’une grande nostalgie. Brahms joue habilement des
couleurs pour faire « glisser » chaque développement dans la phrase suivante et,
imperceptiblement, nous offrir une série de mutations étranges et novatrices.
Malgré un épisode vigoureux et de grande tension, le mouvement s’achève dans
un calme relatif, une sérénité encore douloureuse et que les compositeurs post-
romantiques dont Schoenberg auront gardé la leçon.
Le dernier mouvement, Poco allegro, revient au climat ensoleillé et pastoral du
début de l’œuvre. La complexité de l’écriture et notamment de la fugue centrale se
déploie sans effort apparent dans une sobre tranquillité. Brahms atteint l’un des
sommets de son art, mêlant la saveur populaire à une maîtrise absolue des formes
les plus savantes.