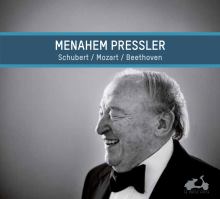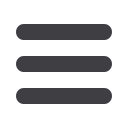

13
MENAHEM PRESSLER
Beethoven, de son côté, densifie son discours.
Comment va-t-il rompre les
digues que lui impose le classicisme ? A quoi peut servir un langage nouveau si
la facture instrumentale ne l’accompagne pas dans sa recherche de sonorités
nouvelles ? La
Sonate Pathétique
porte bien lamention « pour pianoforte ou clavecin ».
Le clavier demeure un outil (mais, Beethoven ne dit-il pas aux musiciens « qu’ai-je
à faire de vos misérables instruments lorsque l’esprit souffle en moi » ?) avec lequel
il peint le théâtre de l’Humanité et ose, pour la première fois, ne plus s’adresser à
Dieu. Il admire Bach et regrette ne pas avoir travaillé avec Mozart.
Dans les rues de Vienne, Schubert croise parfois Beethoven sans
jamais oser lui adresser la parole.
Le compositeur du
Roi des Aulnes
tombe
le masque car ses interrogations touchent à l’essence même de la musique :
quelle est la place de l’artiste dans la société lorsque celui-ci veut, au péril de sa vie,
assumer seul son art sans dépendre de la commande ? Comme Beethoven, mais
avec plus de douleur que de rage, il joue des silences et des non-dits : ce que Vienne
peut tolérer, mais ne veut voir, ce que la police de Metternich instruit, mais que
l’empereur soutient, tout cela prend forme sous les plumes de Beethoven et de
Schubert.
Ces histoires viennoises qui se croisent, si proches
dans le temps et l’espace ne pouvaient naître que
sur les bordsd’unfleuvequi diffuse le sangnouveau
de l’Europe. Vienne flamboie en 1800. Certains y
ont vu la répétition générale du siècle suivant.